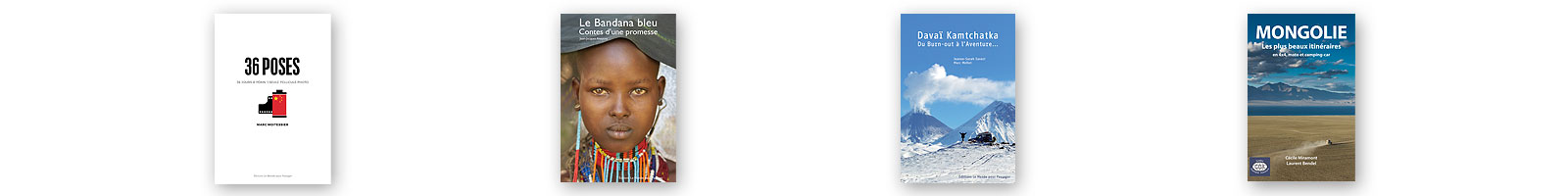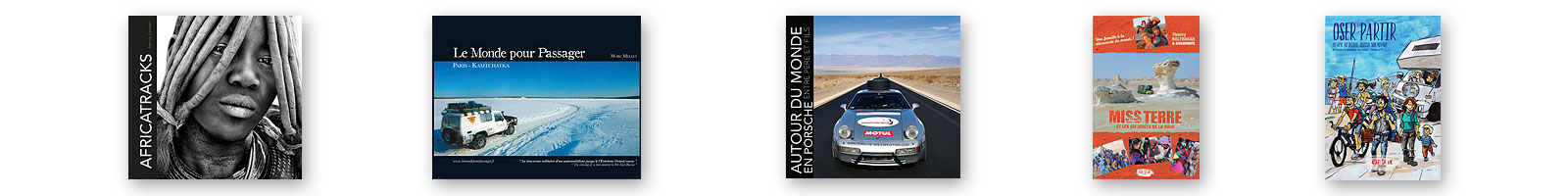Davaï Kamtchatka, du Burn-out à l’Aventure : chapitre offert !
Comment revient-on d’un voyage de deux ans ? Comment se passe le retour d’une telle aventure ?
Forts du succès de la première édition, nous avons créé une version augmentée de Davaï Kamtchatka, du Burn-out à l’Aventure. Pour ne pas léser ceux qui nous ont fait confiance depuis le début. Voici ce chapitre en intégralité. Également, voici le lien pour télécharger ce chapitre sous forme de PDF imprimable : DK-Le dernier chapitre
À la dernière page d’un livre, qui ne s’est pas déjà posé cette question : « Que se passe-t-il après le mot ′fin′ ? Que deviennent les personnages que l’on a suivis le temps d’un récit ? » Dans le cas de la littérature de voyage, il y a sans aucun doute un aspect primordial et peu abordé : le retour. C’est cette expérience qu’il me semble intéressant de développer ici, un an après la parution de la première version du livre Davaï Kamtchatka et un an après notre retour en France.
Si l’une des premières difficultés est d’arriver à partir, il faut également savoir revenir. Un voyage n’est pas complet sans cette notion. Rentrer est peut-être la chose la plus dure, car c’est ce que l’on prépare le moins. À tort, car le retour est souvent un traumatisme. Anticiper « l’après-voyage » est le meilleur moyen de bien le vivre.
« Êtes-vous sûr de vouloir envoyer ce message ? » Juillet 2014, nous sommes au beau milieu d’un petit village de Mongolie. Marc tient dans la main son téléphone, le bras levé en guise d’antenne. Deux minutes plus tôt, j’ai cliqué sur le bouton « envoyer ». Nous attendons depuis que l’e-mail parte. Un message qui donne le go à Philippe, notre maquettiste, pour envoyer à l’imprimeur les fichiers du livre Davaï Kamtchatka. Cet ultime message signifie que nous avons désormais trois semaines pour rallier la France. Si notre connexion GPRS le permet, deux palettes de livres nous attendront bientôt à Vendôme, chez la mère de Marc. De quoi trouver une motivation supplémentaire pour rentrer après deux ans de voyage.
Le trajet n’a pourtant rien d’excitant. C’est un marathon de dix mille kilomètres que nous devons enchaîner en quelques semaines. Nous roulons sans nous arrêter, sans rien voir, ou presque. Nous n’avons pas même le temps d’analyser nos sensations ou notre peur du retour. L’urgence de cette livraison à venir prime sur tout le reste. Nous oscillons entre fatigue et surexcitation.
Nous traversons la Russie d’est en ouest. De quoi se dire une fois de plus que ce pays est décidément bien vaste. Un peu de nostalgie, l’envie d’y revenir un jour reste dans un coin de ma tête. L’Ukraine, que nous voyons à peine, est le dernier pays avant l’Europe. Plus de douanes, plus de visas, plus de difficultés, plus de voyage. À peine sursautons-nous en voyant le panneau France apparaître en bord de route. Ça y est, nous sommes de retour.
J’ouvre grand les yeux devant tous ces mots dans ma langue. Un TGV passe au loin. J’aperçois un facteur à vélo. Tout ceci me semble familier et totalement nouveau à la fois. Vite, un arrêt dans une boulangerie ! Il me faut quelques secondes avant de réaliser que je peux passer commande en français. C’est vraiment dingue ce qui m’arrive. Je suis un peu perdue, complètement survoltée et je souris niaisement. « Wow, du jambon à l’os ! Regarde, Marc, du camembert ! » Il faut l’avouer, notre premier repas est gargantuesque. Nous aurions envie de tout manger, de retrouver tous les goûts qui nous avaient manqués. Pour être plus précise, tous les goûts dont nous avions oublié l’existence.
Peu avant d’arriver chez ma belle-mère, nous nous arrêtons dans une grande surface. Nous y errons, partagés entre dégoût et étonnement. Trop de denrées, trop de choix, trop de tout. Nous n’avons qu’une hâte : sortir de ce temple de la grande distribution. Pendant que Marc part visiter le magasin de bricolage d’à côté, je m’arrête dans une pharmacie. Je compte fêter mon arrivée en renouant avec mon hygiène et ma féminité. En bref, je veux une crème hydratante. J’entre, et me retrouve devant un mur complet de crèmes. Il y en a de toutes les marques, de toutes les tailles, pour toutes sortes de besoins. La tête me tourne et j’ai envie de tourner des talons. Une vendeuse vole à mon secours :
« Je peux vous aider ?
– Heu, oui. Je cherche une crème hydratante.
– Ouuuui plutôt quoi ? Vous aviez une marque en tête ?
– Heuuuuu, une pour hydrater ? »
Je suis au bord de la crise de panique. Je voulais juste une crème hydratante, laissez-moi tranquille !
Commencer par un petit tour dans un supermarché est une mauvaise idée. Le décalage est trop brutal. Il nous faudra quelques mois pour faire abstraction de ces rayons bondés où les prix pratiqués nous semblent trop élevés. Il faut dire qu’après avoir vécu à deux pour 1200 euros par mois, le coût de la vie en France est non seulement un choc, mais est aussi largement au-dessus de nos moyens. Un sentiment fort de surconsommation et de gaspillage nous assaille. C’est un contrecoup logique après notre périple. Un de ceux que l’on a beau prévoir, mais que l’on ne peut s’empêcher de ressentir comme une violente claque.
La boucle est bouclée. Nous arrivons à destination, plus morts que vifs. Pas le temps de souffler. En un temps record, nous devons vider et laver la voiture, réceptionner les livres, remplir à nouveau la voiture. C’est un mouvement perpétuel. Pendant ce temps-là, les téléphones sonnent sans arrêt. Nous redécouvrons la possibilité de prendre bêtement notre téléphone pour appeler nos proches. Plus besoin de calculer le décalage horaire. Un petit miracle qui nous permet d’entendre des voix que nous n’avions pas entendues depuis deux ans. Chaque coup de fil s’éternise, même si nous sommes un peu à court de mots. Comment résumer deux ans de vie en quelques paroles ? C’est un exercice impossible. Et puis, il faut avouer que nous sommes un peu perdus. Nous sommes fatigués, presque ivres de toutes ces nouveautés. Tout va trop vite et nécessite à nouveau de s’adapter.
Le transporteur arrive et nos deux milles exemplaires du livre avec lui. Quelle satisfaction de pouvoir l’avoir entre les mains ! Il est le résultat de deux ans de travail. J’ai passé des mois enfermés dans une yourte devant un écran d’ordinateur. Mes bébés ! Je lève les yeux, vers Marc. Est-il ému, lui aussi ? Il se saisit d’un livre, le déchire, le tape, le jette par terre, le piétine. Il me regarde enfin et rit en me disant tout simplement : « Je teste la qualité de la reliure. » Je sens bien que je dois être un peu blanchâtre, les yeux exorbités. J’articule faiblement : « C’est ça que tu fais de nos enfants ? »
Nous sommes dans un état euphorique. C’est le temps de la joie et des grandes embrassades. Nous revoyons enfin nos proches. Les questions fusent, et je perçois confusément que cet état second ne va pas durer. J’ai un peu peur de ce retour. Marc m’a prévenu qu’il pouvait être difficile. Lors de son dernier grand voyage, il avait fait une violente déprime. Par ailleurs, notre entourage nous martèle impitoyablement que « revenir doit être horrible. » Pour le moment, je n’en suis pas là, et je mâchonne en savourant pleinement ma côte de bœuf. Ah, ce qu’elle a pu me faire rêver celle-ci !
Il s’est passé à peine cinq jours depuis notre retour en France, que nous volons littéralement jusqu’à la Foire du Tout Terrain de Valloire. Il y a deux ans, nous étions partis d’ici. Quand nous étions encore dans notre yourte en Mongolie, Marc me disait : « Tu sais, les gens nous attendent en France. » Qui ? Je pense à ma famille, à mes amis, mais imaginer que des inconnus nous attendent me fait un peu peur. C’est vrai que je n’ai sans doute jamais réfléchi aux personnes qui nous lisaient sur le site internet ou dans les magazines. Le salon de Valloire est l’occasion d’aller à leur rencontre. Cette perspective me met mal à l’aise. C’est un sentiment étrange que d’être propulsé sans le vouloir sur le devant de la scène. Ce passage de l’ombre à la lumière n’est pas fait pour moi. Soyons clairs, j’ai peur.
Marc avait raison, nous sommes littéralement pris d’assaut. Exclamations de joie de à notre vue : « Tu es là ! Ça fait plaisir ! » Je réfléchis à toute allure, perdue : « Qui est-ce ? » « Tu ne me connais pas. » Soulagement, je ne perds pas encore la mémoire. Des centaines de personnes défilent chaque jour sur notre stand. C’est du délire. Tous ces gens ont attendu chaque mois la suite de nos aventures dans le journal. Tenus en haleine, ils connaissent notre histoire par cœur. Certains me rappellent des moments du voyage que j’avais presque oubliés. Je n’avais pas conscience qu’une publication provoquerait cet engouement. Je ne pensais pas que notre voyage passionnerait autant de monde. Peut-être ne voulais-je pas penser à cet aspect des choses. Je suis face à ceux qui nous ont suivis, ceux que l’on a fait rêver. Je souris, mais je suis un peu débordée par les événements. Je touche du doigt ce qui pouvait me mettre mal à l’aise. Ma propre histoire m’échappe. Mon voyage est un conte sur lequel je n’ai plus prise. Suis-je devenue un personnage de fiction ? Cette créature qui est moi et qui ne l’est pas tout à la fois a pris son indépendance. Cet avatar est devenu la super-héroïne que je ne suis pas. Je ne me reconnais pas forcément dans les yeux de certains lecteurs un peu trop enthousiastes. On me dit que je suis un peu dingue ou courageuse. Je ne sais pas, peut-être en fait. Je ne sais plus où je suis ni qui je suis. Les compliments exagérés m’interrogent. Je rétorque inlassablement : « Vous savez nous nous sommes régalés durant ce voyage, il n’y pas besoin de dire bravo ! ». Bien sûr, partir est un choix courageux, c’est vrai que nous avons vécu des choses un peu dingues. C’est bien à cause de tout ceci que j’ai décidé d’écrire un livre. Mais cet engouement me semble disproportionné. C’est fou à quel point certains se sont littéralement approprié notre voyage et notre vécu. Qui a raison et qui a tort ? Réaliser un long voyage apprend l’humilité. Aussi, tant d’éloges me mettent mal à l’aise. Être portée aux nues pour avoir pris du plaisir ? Cet aspect des choses pourrait facilement faire tourner la tête à n’importe qui. À notre petite échelle, je reste plus que jamais consciente que c’est la médiatisation qui démultiplie notre aventure. Le voyageur n’a pas besoin de cette mise en lumière pour apprécier ou se lancer dans un périple.
Je n’espère qu’une chose, que notre voyage permettra à d’autres de réaliser leurs rêves ! J’accepte de servir d’exemple si je suis censée prouver que n’importe qui peut se dépasser. Une part de responsabilité me tombe sur les épaules, un statut que je n’avais pas anticipé une seule seconde. Je suis étiquetée aventurière, baroudeuse de l’extrême, spécialiste es voyages.
Tout ceci, en plus du décalage du retour, est un peu perturbant. Durant le voyage, je me suis découverte, j’ai été confrontée à moi-même et à mes peurs. Au retour, je suis catapultée face à une image de moi que je ne reconnais pas. Preuve que l’exploration continue et que ma métamorphose s’achève un peu ici. Je ne peux plus me cacher ce que je suis devenue. C’est à ce moment que commence l’acceptation des changements survenus en deux ans. Je dois réaliser qu’en écrivant mon histoire, j’ai embarqué à ma suite une pléthore d’inconnu. J’étais parti pour un voyage qui s’est transformé en aventure. J’ai décidé de partager mon vécu, et en faisant cela, j’accepte qu’il devienne une expérience commune à mes lecteurs.
Nous avons à peine le temps de réfléchir à ce qu’il nous arrive. Nous sommes happés par la foule, par les questions, par de nouveaux projets. Et dire que nous avions peur qu’une fois de retour tout s’arrête brusquement ! Nous ne savons plus où donner de la tête. Une course effrénée nous fait parcourir la France de long en large, puis partir en Allemagne sur un rassemblement. Trois semaines après notre arrivée en France, j’avise sans réfléchir un panneau en face de moi. J’y lis « Kevav » sans en comprendre le sens. Je réfléchis quelques secondes avant d’éclater de rire. En russe, la lettre « B » se lit « V ». Je suis tout bêtement en face d’un Kebab. Mon cerveau n’a pas encore eu le temps de se remettre à l’heure française.
Le retour est rapide et, de ce fait, nous avons le sentiment d’être un peu brutalisés. Pourtant, nous tentons d’atterrir en douceur pour amortir le choc. Instinctivement, nous nous tournons vers les personnes que nous avions vues pendant le voyage. Nous dialoguons plus volontiers avec ceux avec qui nous étions en contact régulier. De manière naturelle, nous effectuons ainsi une transition indispensable pour quitter lentement le voyage.
Ce n’est qu’après un mois passé en France que nous arrivons sur Paris. Trois jours plus tard, je pars rejoindre mes anciens collègues pour un déjeuner à La Défense. Être à Paris, prendre le métro et arriver dans cette forêt de tours est surréaliste. C’est d’autant plus étrange que je me sens parfaitement sereine et détachée. Je suis heureuse de revoir tout le monde. « Que comptes-tu faire maintenant ? » me demandent-ils. « Trouver du travail » dis-je. « Ça tombe bien, la personne qui t’a remplacée part en congé maternité. Ça ne te dirait pas de revenir pour quelques mois ? » « ?!!! ». Mon cerveau tourne à toute vitesse. Est-ce une bonne idée ? N’est-ce pas un peu trop tôt ? Suis-je encore capable de travailler dans un bureau ? Est-ce que je ne risque pas de m’enfermer à nouveau dans la spirale infernale qui mène au burn-out ? Oh, mon dieu, ça va un peu vite tout ça. En même temps, c’est la première fois de ma vie qu’un entretien d’embauche se résume à une question très simple : « Oui ou non ? » Je prends 24 heures de réflexion. Je pèse soigneusement le pour et le contre. D’un point de vue purement pratique, je n’ai pas de revenus, la vie coûte cher ici, je n’ai plus de sécurité sociale. Travailler va nous permettre de récupérer notre appartement parisien actuellement en sous-location. Et pourtant, est-ce le bon choix ? Ça peut paraître fou, après avoir vécu un burn-out là-bas, mais je sens bien qu’il faut que je saisisse cette opportunité. Il est peut-être plus simple de reprendre une activité dans un environnement connu. L’adaptation demandée sera moins forte. Et puis, quoi de plus intéressant que de voir et de comparer mon évolution à périmètre constant. Suis-je vraiment guérie ? C’est un pari risqué, mais après tout, ne suis-je pas censée être une aventurière ? J’appelle la Directrice « C’est Ok pour moi. » « Parfait, tu commences lundi. » Ah oui quand même, ça va très vite.
Et me voilà, par un matin pluvieux, un café à la main, debout dans un bureau que j’ai bien connu. Un jean, un petit haut, une belle manucure, un peu de maquillage et perchée sur de hauts talons. La panoplie de la working girl est de sortie après bien longtemps. Un équipement dont j’avais oublié l’existence et que j’ai redécouvert en rentrant avec pas mal de questionnements. Tiens, j’avais ça moi ? Et ça aussi ? Et puis ça encore ? Mais en fait, pourquoi ai-je autant de fringues ? Au fil des mois, je me rends compte néanmoins que j’ai toujours la même addiction pour les chaussures. Preuve s’il en fallait, que le voyage n’est jamais une métamorphose totale !
En attendant, ce matin-là, je n’en mène pas large dans mes petits escarpins. Je regarde le paysage au-dehors. Que d’heures passées ici ! Je suis à la fois pensive et étonnée. C’est étrange, c’est comme si je n’étais pas partie, comme si j’avais rêvé ces deux années de voyage. C’est effrayant, car j’ai peur de renouer avec des rythmes effrénés et de perdre l’enseignement de deux ans de voyage.
Passé le flottement de la première semaine, je me rends compte avec étonnement que mon cerveau s’adapte très facilement. J’avais vu juste, le retour dans un domaine que je connais bien est plus simple. Et pourtant, les choses ont changé. Déjà, parce que le poste que j’occupais à moi seule a été divisé en deux. La charge de travail est moins folle. Et puis surtout, j’ai changé. Si mes collègues n’en reviennent pas de la rapidité avec laquelle je me plonge dans les dossiers, ils perçoivent également très vite que rien ne sera plus comme avant. 18 heures : « Jeanne, est-ce que tu… » « Oui, dès demain. Bonne soirée. » Pour autant, est-ce pour cela que mes supérieurs m’apprécient moins ou que mon travail est moins bien fait que lorsque je restais mes soirées au bureau ? Non. Je ne tente plus d’être un super-héros au travail, j’ai compris que cela ne servait à rien. J’ai d’ailleurs réalisé que je n’étais pas un super-héros. Vouloir être forte à tout prix n’a pas de sens, il faut aussi accepter de se sentir faible ou fatiguée. Il faut apprendre à s’écouter. Mon burn-out a été en partie déclenché par une charge de travail démesurée et une pression très forte. Mais au-delà de soucis de hiérarchie ou de positionnement, c’est l’exigence envers moi-même et l’incapacité de prendre du recul sur mon travail, qui ont fini par m’emmener au bord du gouffre. Les torts se partagent entre une organisation qui fait pression sur ses employés et les employés qui donnent trop à cette organisation. Un cercle vicieux se crée et mène à la déroute. L’engagement sans la reconnaissance peut être facteur de découragement, amenant à la dépression ou à la démission. Il est important de garder une certaine limite entre son emploi et le reste de son temps et de sa vie. Cela ne signifie pas pour autant de ne pas s’investir dans son travail, mais de trouver l’équilibre entre son engagement, le plaisir que l’on en retire et la reconnaissance.
En riant, je passe mon temps à expliquer à des collaborateurs stressés que nous ne sauvons pas des vies et que la notion d’urgence dont on nous rebat les oreilles au quotidien est toute relative. J’ai pris du recul, et je leur en fais part également. J’assiste, en spectatrice, au désarroi d’autres collègues au travail. Mon rapport aux autres change et je me retrouve un peu la confidente d’un certain mal-être au travail. Ai-je changé, en dehors du fait que j’ai vieilli de deux ans ? Je suis ce que j’étais avant pendant et après ce voyage. Pourtant mon entourage au travail me perçoit différemment. Ce qui me renvoie à la question suivante : « Est-on ce que l’on fait ? » Cette définition est réductrice si l’on ne se désigne que par un titre. « Je suis chargée de communication » par exemple, ou « je suis voyageuse ». La vérité est bien différente. Je suis chargée de communication, je suis voyageuse, je suis aussi journaliste, écrivaine, archéologue. Je suis tout cela à la fois, et non, je ne suis pas schizophrène. Le voyage, par exemple, est une expérience, mais ne définit personne.
Cet exercice peu évident de revenir travailler à mon ancien poste est intéressant à plusieurs titres. Je ne renie pas ce que j’ai fait, je ne tire pas un trait sur mon voyage. Le retour ne signifie pas un retour en arrière. Ce voyage fait partie de moi. Je suis heureuse d’avoir un jour tout plaqué pour le faire. Je veux garder l’essence de ces deux ans. Je ne veux pas en tirer une nostalgie qui tendrait vers l’amertume. Je n’ai rien perdu en rentrant, au contraire. Revenir me permet de réaliser à quel point ce périple m’a apporté. J’ai appris beaucoup de choses sur les autres et sur moi-même. J’ai pris confiance en moi et en l’autre, car j’ai appris le sens du mot « écoute ». J’ai moins de peurs et la sensation aiguë que mes propres limites sont extensibles à l’infinie. Ma vision du monde est différente. Mes aspirations au voyage et à la découverte restent intactes.
Même en restant en France, les choses ont changé pour tout le monde. Il est bon de rappeler qu’on a beau être une aventurière, on n’est pas pour autant déconnectée des réalités. Je suis comme tout le monde, je ne vis pas de voyages et d’eau fraîche. Je dois aussi subvenir à mes besoins, j’ai des amis, une famille. Bref, je suis dotée de tout ce qui est un frein à un long voyage. Toutes les bonnes raisons que me donnent les gens pour ne pas partir. Comme si je n’avais pas les mêmes problématiques qu’eux : manque de temps, d’argent et une famille à voir. J’ai fait un choix à un moment donné, et je le referais sans hésiter. C’est pourquoi j’aime l’honnêteté de certains. Ils ne se cherchent pas d’excuses, ils avouent, tout simplement : « Je n’ai pas le courage. » Je trouve que c’est justement courageux de l’admettre.
Alors, le retour, est-ce si dur que je le pensais ? Le plus difficile est de rester soudainement « statique ». D’un coup, on se sent physiquement immobile. En attendant de pouvoir payer le loyer de l’appartement que nous sous-louons, nous utilisons un studio de 18 m². Si beaucoup nous affirme : « Quel luxe après vos deux ans dans 3 m³ », nous avons surtout la sensation que la vue de la fenêtre est bien monotone et le jardin autour, bien petit. Ici, à Paris, j’ai le manque des grands espaces.
Alors que j’ai repris la direction du bureau, Marc continue seul à arpenter les salons pour vendre les livres et passe son temps sur les routes. Nous sommes trop souvent séparés et c’est un choc. Mon équilibre des derniers mois tenait à sa présence quotidienne. Marc me manque. Quand il m’annonce qu’il part pour trois semaines de travail au Tchad, j’ouvre de grands yeux tristes. « Ne sois pas triste que je parte » me dit-il. Je rétorque : « Je ne suis pas triste, je suis tout simplement verte de jalousie ! Comment ça tu vas découvrir un pays alors que je reste là ! »
Revenir est une chose, se réadapter en est une autre, mais revenir à deux ? Dans un sens, c’est une vraie chance et un atout pour bien vivre le retour. Si j’ai parfois la sensation d’être en décalage avec les autres, Marc peut comprendre les souvenirs qui voilent parfois mon regard. Un sourire et un regard complice permettent de ne pas se sentir seul. Et si le plus dur dans un retour était la solitude de sa propre expérience ? Un vécu commun aide. Il est donc d’autant plus douloureux d’être loin de l’autre. Malgré ce que l’on pourrait penser, le retour est aussi difficile à gérer qu’un départ ou un voyage pour un couple. Il faut que chacun retrouve sa place au quotidien. Que chacun retrouve sa place dans le couple. Il faut réussir à changer de rythme à nouveau, à deux et continuer de regarder dans la même direction. Les difficultés nous ont soudés, mais l’épreuve du retour peut faire exploser un couple en plein vol.
Les mois filent à toute allure, les projets s’enchaînent. Une fois la joie des retrouvailles passées nous reprenons petit à petit nos repères. Nous revenons dans notre appartement. Un « chez nous » autre que la voiture. Garder un lieu fixe que l’on peut appeler sa maison est primordial pour se sentir bien. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce retour s’est plutôt bien passé. Tout s’est fait naturellement, presque sans le vouloir. Pourtant, avec le recul, je pense que nous avons inconsciemment mis tout en place pour qu’il se passe au mieux. Écrire et raconter permettent de mettre une distance entre le voyage et notre nouveau quotidien. Les salons auxquels nous participons sont des lieux d’échanges qui nous évitent les frustrations que nous pourrions avoir devant le manque d’intérêt légitime de notre entourage. Il faut accepter que nos proches passent rapidement à autre chose. Certains ne posent que peu de questions, ou ne s’intéressent pas vraiment à notre expérience. Une fois de plus, c’est à nous de nous adapter et d’accepter l’absence de curiosité pour un choix de vie qui nous est propre. Et puis, il y a tout simplement une chose primordiale pour bien vivre ce retour, il faut avoir envie de rentrer. Nous avons eu envie de rentrer, car nous avions eu le sentiment d’être allés au bout de ce voyage. « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… »
Pour chacun, il s’agit désormais de prendre le temps de se retrouver et de reprendre ses marques. Un équilibre à trouver entre vivre ici, intégrer son expérience et les changements qu’elle induit. Et puis, surtout, il faut continuer de rêver et de concrétiser ses rêves. Loin d’être une fin, c’est le début de nouvelles aventures, quelles qu’elles soient. Un voyage réussi est aussi un retour réussi, celui qui permettra de repartir un jour dans de bonnes conditions et pour les bonnes raisons. Car pour y avoir goûté, le frisson délicieux de l’exploration ne demande qu’à se réveiller.
Retrouvrez ce chapitre dans le livre Davaï Kamtchatka, du Burn-out à l’Aventure disponible dans notre boutique.
21,90 € frais de port offert.